BNP Paribas Open - WTA
-
Aryna Sabalenka (1)
A. Sabalenka (1)
-
Elena Rybakina (3)
E. Rybakina (3)
- vs
Date du match
15 mars 2026 à 19:00
Match à venir.
BNP Paribas Open - WTA.
Finale.
Aryna Sabalenka, Biélorussie , Tête de série 1 , contre Elena Rybakina, Kazakhstan , Tête de série 3 . Date du match : 15 mars 2026 à 19:00.
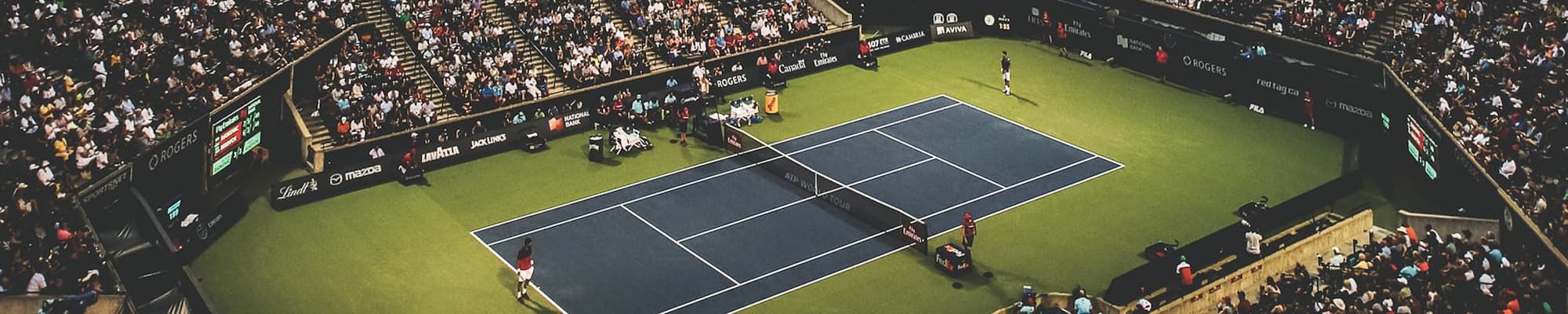

































 BNP Paribas accompagne
BNP Paribas accompagne