Guadalajara Open
-
Nikola Bartunkova (WC)
N. Bartunkova (WC)
-
Magdalena Frech (4)
M. Frech (4)
- vs
Match à venir.
Guadalajara Open.
Quart de finale.
Nikola Bartunkova, République Tchèque , Wild-card , contre Magdalena Frech, Pologne , Tête de série 4 . Commence bientôt.
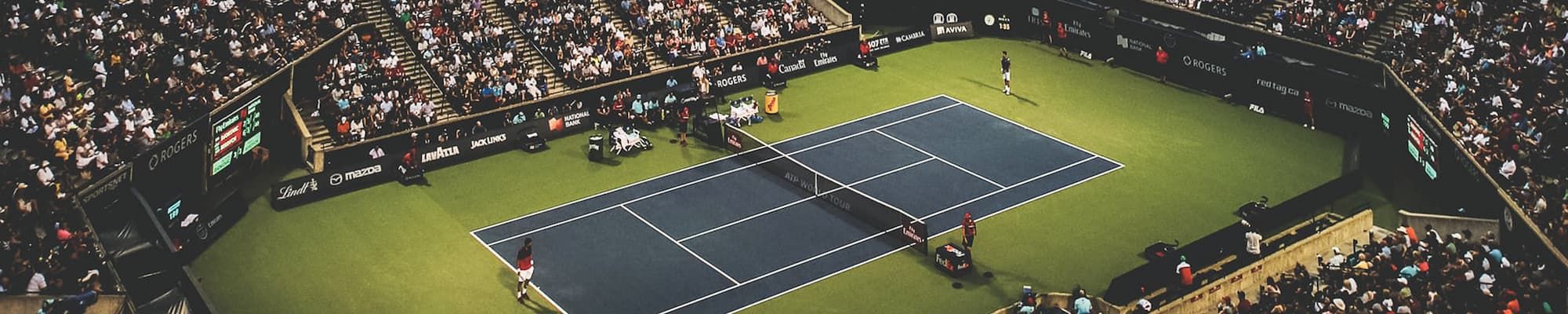


















 BNP Paribas accompagne
BNP Paribas accompagne